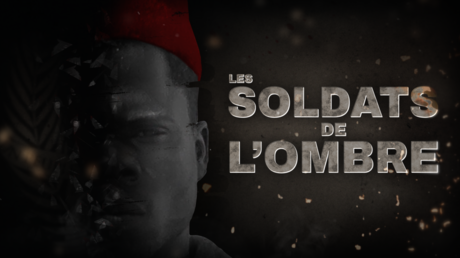Pour Karine Bechet-Golovko, les pourparlers à Istanbul conduisent à un sentiment mitigé : s’ils forcent les Ukrainiens à prendre la mesure de leur responsabilité politique, ils renforcent la fausse position d’arbitre revendiquée par les États-Unis dans leur propre guerre, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la Russie si elle veut une paix équitable.
Pourparlers bilatéraux russo-ukrainiens : un coup tactique
Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Poutine a proposé une rencontre bilatérale avec l’Ukraine à Istanbul le 15 mai, sans conditions préalables. De cette manière, la Russie répondait à l’impératif de cessez-le-feu généralisé, exigé par les atlantistes européens et soutenu par Trump. Mais cet ultimatum, écarté un instant, est déjà de retour.
Après beaucoup de gesticulation, Zelensky a donné son accord. Évidemment, le 15 mai, alors que la délégation russe était sur place, les Ukrainiens ne sont pas venus.
Tout d’abord, les atlantistes voulaient forcer le président russe à se déplacer. L’appât d’une possible rencontre avec Trump, qui jouait le jeu du « sait-on jamais », devait conduire la Russie à commettre cette erreur. Mais la ligne fut tenue fermement : une rencontre est toujours possible, mais elle doit être très bien préparée.
Ensuite, toute la pression politico-médiatique portait sur la nécessité d’imposer un cessez-le-feu généralisé, c’est-à-dire d’arrêter l’avancée de l’armée russe pour permettre aux atlantistes de reprendre des forces. Les derniers cessez-le-feu partiels ayant été allègrement violés par l’armée atlantico-ukrainienne, la Russie n’a plus confiance en ces déclarations.
Finalement, le 15, on apprend qu’un conseiller britannique débarque pour discuter avec les Ukrainiens, les Turcs s’imposent pour une rencontre désormais tripartite le 16 mai et les Américains veulent imposer le représentant, ce qui ne sera pas réalisé. Mais la Turquie, pays de l’OTAN, organise alors deux rounds de négociations. Le premier avec les Américains et les Ukrainiens, puis ensuite avec les Russes et les Ukrainiens. L’ordre et la formalité ne sont pas anodins : en politique la forme a autant d’importance que le fond. Les atlantistes font spécialement attendre la Russie, ils veulent la mettre en position de demandeur et ils le font savoir. La Turquie sert évidemment ces intérêts et ne laisse pas l’Ukraine seule face à la Russie, elle lui accorde sa protection.
Absence de résultats concrets : les pourparlers sont un but en soi
Sans aucune surprise, les pourparlers tripartites russo-ukraino-turcs n’ont pas même abouti à un début de résolution des sources du conflit, puisqu’il n’en a pas été question lors de la discussion. Un important échange de prisonniers, 1 000 de chaque côté, a été convenu, ce qui est finalement le seul apport réel.
Pour le reste, il est convenu que l’Ukraine et la Russie mettent sur papier leur vision d’un cessez-le-feu, sans qu’une date ne soit précisée. Et c’est bien la seule chose, qui intéresse les atlantistes. Ce qui souligne encore une fois s’il le faut que les pourparlers aujourd’hui ne permettront pas à la Russie de régler à la source le conflit avec les atlantistes, qui se déroule en Ukraine.
C’est le processus en lui-même qui intéresse les atlantistes plus que le résultat. Sauf si la Russie accepte d’arrêter d’elle-même son armée. En ce sens, les pourparlers sont un front comme un autre, qui doit permettre d’obtenir par la diplomatie ce qu’il n’est pas possible d’obtenir par les armes.
Les dégâts « collatéraux » du processus de négociation
Pour autant, ce processus n’est pas neutre et produit de sérieux dégâts collatéraux. Certes, les atlantistes de tous bords montrent leur véritable visage : ils veulent une victoire plus que la paix. Mais à qui montrent-ils ce visage ? À la Russie ? Comme si elle ne le savait pas. À leurs alliés ? Dans ce cas, cela produit un effet de galvanisation, ce qui est positif dans le cadre d’un conflit armé.
Étrangement, la Russie, en voulant soi-disant prendre le contre-pied, ne parle que de paix et quasiment jamais de victoire, reprenant en fait le discours trumpien. Elle enchaîne les « gestes de bonne volonté », tient les moratoires de manière unilatérale et n’ose jamais dire non. Le refus semble être banni, comme une faute de goût impardonnable, comme s’il fallait montrer patte blanche. Mais à qui ? À ses ennemis, pour leur dire que l’on est prêt pour la paix, plus que pour la victoire ? Ce n’est pas le meilleur moyen de les dissuader d’aller plus loin, ni de les conduire à vous prendre au sérieux ou d’avoir peur. Et cela est interprété comme de la faiblesse.
Cette ligne politico-médiatique a par ailleurs pour effet direct de démobiliser la société russe – qui se met à attendre la « paix » (sans se demander laquelle) puisqu’elle n’entend parler que de cela du matin au soir. Il ne faut pas non plus négliger les risques de démotivation sur le front, où la propagande ennemie peut alors avoir plus de poids, sur le mode « pourquoi se battre, si l’essentiel n’est pas une hypothétique victoire dont personne ne parle, mais de mettre en place des conditions favorables pour ensuite revenir négocier ? ». La mobilisation morale des forces vives de la société est pourtant fondamentale en période de guerre.
Cet effet se voit aussi avec les « amis » de la Russie, qui ne cessent d’appeler à la « paix », à un « cessez-le-feu », à une rencontre magique entre Trump et Poutine qui devrait tout régler. Amen ! Ils ne parlent jamais de la victoire de la Russie, ils ne l’envisagent même pas. Et la Russie n’en parle pas non plus avec eux. Ces « amis » veulent revenir dans le monde d’avant, cette guerre n’est pas la leur, ils veulent l’oublier comme un mauvais songe. Ils refusent de voir le caractère existentiel de cette guerre pour la liberté des peuples et la souveraineté des États. Ils ne contestent pas en réalité l’ordre global existant, ils le critiquent simplement parfois dans les détails, mais ne pensent pas le remettre en cause. Tant que la Russie poursuit ce discours hypnotique « la paix, la paix, la paix », elle ne pourra pas avoir de véritables alliés solides, elle ne pourra pas amener à elle les forces, qui existent pourtant, et qui mènent le même combat qu’elle, à leur manière, à leur échelle.
Enfin, la protection des Américains depuis l’arrivée de Trump au pouvoir, avec un discours politico-médiatique russe uniquement orienté vers une critique des Européens et des Ukrainiens, est particulièrement contre-productif. Faire tout à coup de l’Ukraine et de Zelensky un État souverain et un véritable chef d’État est en soi un contresens. L’Ukraine a perdu son étaticité au minimum en 2014, elle est au mieux un protectorat, en réalité un front. Maintenir l’illusion de son existence juridique et politique, c’est refuser de prendre en compte la réalité et fausser la perception de l’opinion publique des enjeux et des sources du conflit. La Russie ne se bat pas contre l’Ukraine, mais en Ukraine, ce que la Russie répète par ailleurs. Et ce qui est incompatible avec la résurgence d’un Zelensky, figure gouvernante d’un État souverain.
Par ailleurs, le mythe du gentil Trump pacifiste vs. les méchants européens belliqueux a fait long feu. À chaque réunion des élites atlantistes européennes, des échanges ont lieu avec Trump, qui valide systématiquement leur position. Toutes les exigences de Trump concernant la remilitarisation de l’Europe et l’augmentation de sa contribution financière à l’OTAN ont été satisfaites. Trump valide l’exigence atlantiste d’un déploiement de forces militaires de l’OTAN en Ukraine face à la Russie ; il exige le contrôle américain de la centrale atomique de Zaporojie ; il a établi par accord avec Zelensky la suprématie du droit américain sur le droit ukrainien dans leurs échanges en Ukraine (sans en préciser les frontières). Si Trump veut la paix, il est temps de reconnaître qu’il veut la paix « atlantiste ». Et pour le faire comprendre, il martèle la victoire américaine lors de la Seconde Guerre mondiale, voulant ainsi détruire l’un des piliers fondamentaux du Monde russe et ainsi affaiblir son... ennemi. Il n’est ni un Deus ex Machina, ni un ami, ni un arbitre. Il est à la tête du Monde global, ce qu’il revendique par ailleurs.
Protéger la figure de Trump, accepter qu’il se présente comme arbitre de sa propre guerre comme cela est le cas aujourd’hui, n’a pas de sens pour la Russie, car cela renforce la position des États-Unis. Trump n’offrira pas la victoire à la Russie, il n’a pas même fait de concessions réelles – toutes les sanctions anti-russes ont été reconduites, les accès aux ports sont bloqués pour les navires russes, des sanctions financières ont été adoptées et le Sénat discute d’un paquet de sanctions et de taxes sans précédent contre la Russie.
Les effets potentiellement positifs du processus de négociation
En soi, les négociations sont un élément des conflits. Mais pour qu’elles puissent produire des effets positifs pour la Russie, celle-ci doit adapter son discours politico-médiatique et pas en faire un culte omniprésent. Ainsi, au minimum deux conditions doivent être remplies pour que le narratif russe puisse être diversifié et cibler ses destinataires : nommer véritablement l’ennemi atlantiste dans son entièreté, c’est-à-dire en cessant de protéger Trump ; préciser de quelle « paix » concrètement il s’agit, ce qui passe par la réhabilitation du terme de « victoire », en contre-poids.
En période de guerre, le discours politico-médiatique doit jouer un rôle performatif important, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est-à-dire qu’il doit contribuer à créer une réalité et une réalité différente à l’intérieur et à l’extérieur. Sans rééquilibrer le narratif, qui est aujourd’hui unique pour les deux publics différents, le discours russe perd son potentiel performatif. Il produit alors des effets nocifs à l’intérieur (en légitimant in fine le discours atlantiste et ceux qui le portent), quand il est dénué de son effet dissuasif à l’extérieur.
Sur le fond, le processus de négociations avec l’Ukraine oblige les dirigeants ukrainiens de pacotille à revenir dans le réel de la confrontation politique : la marionnette doit agir et elle n’est pas prévue pour cela. Ceci explique pourquoi ils ne pouvaient pas venir le 15 mai et surtout sans la protection otanienne, des Turcs et des Américains.
Si l’Ukraine n’est pas un sujet, cela ne vaut pas dire que ces dirigeants locaux peuvent faire tout et n’importe quoi sans aucune responsabilité. Les amener à la table des négociations est un bon moyen de leur remettre les pieds sur terre, si le discours tenu par la Russie est ferme. Et, si l’on en croit les « fuites » dans les médias ukrainiens, il semblerait que la fermeté fut de mise, puisqu’en subtance la délégation russe a exigé la reconnaissance des nouveaux territoires dans leurs frontières administratives et le départ de l’armée d’occupation atlantico-ukrainienne de ces quatre régions... précisant que la prochaine fois s’ajoutera la cinquième, celle de Soumy, afin de créer une zone tampon.
Les atlantistes ont refusé en bloc. Zelensky n’avait pas mandat pour cela. Ils estiment ces exigences russes démesurées. Pour la Russie, elles constituent le minimum vital.
Comme tout art, la négociation exige que ses règles soient respectées pour produire les effets attendus. En recalibrant certains éléments, la Russie peut se doter d’une arme non négligeable et la retourner contre les Occidentaux, qui s’estiment aujourd’hui les mieux qualifiés pour la manier. D’où leur insistance à amener la Russie sur ce terrain.